
Intégration africaine : un rêve en marche lente, Madagascar face à ses contradictions
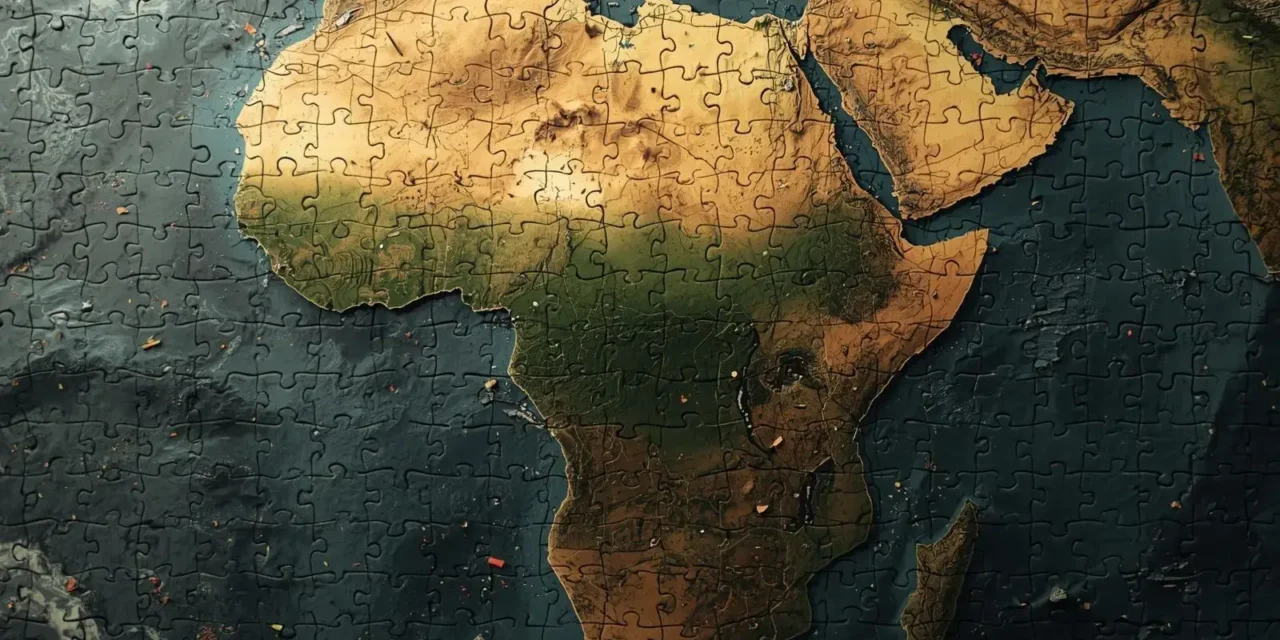
Nous avons analysé le dernier Rapport sur l’intégration africaine 2025. Ce document, produit à l’échelle continentale, se veut un baromètre de l’unité africaine. Mais à sa lecture, une vérité s’impose : l’Afrique avance, mais elle avance à reculons. Les discours flamboyants cachent mal les lenteurs de la mise en œuvre, les promesses s’empilent alors que les peuples attendent encore que l’intégration devienne une réalité vécue.
L’Afrique, entre vision et mise en œuvre
Depuis des décennies, l’Afrique a multiplié les initiatives : création de la Zone de libre-échange continentale (ZLECAf), projets d’infrastructures régionales, accords de libre circulation. Le rapport constate que ces chantiers ont ouvert des perspectives inédites.
Mais le constat est sévère :
- Institutions fragiles, souvent dépendantes de financements extérieurs.
- Faible commerce intra-africain (encore en dessous de 20 % des échanges totaux).
- Fragmentation politique et conflits récurrents.
- Exclusion persistante des jeunes et des femmes des processus de décision.
- En d’autres termes, l’intégration africaine reste encore un horizon, pas un vécu.
Madagascar : l’angle mort de l’intégration ?
Dans ce rapport, Madagascar apparaît comme un cas particulier, presque un angle mort de l’intégration africaine. Insulaire, isolée géographiquement, l’île reste marginalisée dans les flux commerciaux intra-africains.
Quelques éléments clés ressortent :
- Faible participation au commerce intra-africain : la grande majorité des exportations malgaches (vanille, nickel, litchi) part vers l’Europe, l’Asie et les États-Unis. L’Afrique reste une destination secondaire.
- Infrastructures déficientes : ports vétustes, liaisons maritimes irrégulières, routes intérieures dégradées qui freinent les échanges régionaux.
- Intégration institutionnelle limitée : Madagascar est membre de la SADC et du COMESA, mais son engagement effectif reste faible, faute de volonté politique et de moyens financiers.
- Opportunités inexploitées : le rapport souligne pourtant que Madagascar pourrait être un acteur majeur dans l’économie bleue (pêche, commerce maritime, énergies marines) et dans la transition numérique, grâce à sa position stratégique dans l’océan Indien.
- Les blocages structurels de la Grande Île
Les faiblesses malgaches recoupent les critiques globales du rapport :
- Gouvernance fragilisée par la corruption et la financiarisation de la politique.
- Absence de politique industrielle sérieuse, qui empêche de transformer localement nos ressources.
- Dépendance aux bailleurs qui affaiblit l’autonomie stratégique.
- Faible inclusion de la jeunesse dans les décisions, alors qu’elle est en première ligne des frustrations et des révoltes.
Quelles pistes pour Madagascar dans l’intégration africaine ?
Le rapport ne se contente pas de dresser un constat. Il ouvre des pistes, dont plusieurs concernent directement Madagascar :
- Construire des ponts maritimes et numériques : Madagascar doit investir dans ses ports, ses câbles sous-marins et sa connectivité pour s’arrimer aux flux africains.
- Valoriser l’économie bleue : pêche, commerce maritime, énergies renouvelables marines, coopération avec les îles voisines (Maurice, Comores, Seychelles).
- Renforcer la transformation locale : créer des chaînes de valeur régionales autour de la vanille, du textile, des mines.
- Miser sur la jeunesse : reconnaissance régionale des diplômes, mobilité académique, insertion dans les instances de gouvernance.
- Réformer de l’intérieur : sans institutions solides, toute stratégie d’intégration restera un mirage.
Rompre l’isolement, rompre le cycle
Ce rapport est un miroir. Il dit l’Afrique telle qu’elle est : pleine de visions mais prisonnière de ses contradictions. Et Madagascar, plus que d’autres, illustre cette fracture : riche en potentiel, pauvre en intégration.
Rompre l’isolement de la Grande Île ne passera pas seulement par les navires et les câbles : cela passera par un changement profond de notre gouvernance, par une réappropriation citoyenne de notre destin.
La Génération Z malgache, déjà en révolte dans nos rues, réclame dignité et avenir. L’intégration africaine ne peut rester un slogan dans les palais présidentiels : elle doit devenir un projet vécu par les peuples, dans leur quotidien.
Madagascar est à la croisée des chemins. Soit nous restons spectateurs de l’intégration africaine, soit nous en devenons un acteur à part entière. La différence ne viendra pas des traités, mais de notre capacité à transformer l’énergie de notre jeunesse en un nouveau départ national et continental.
















